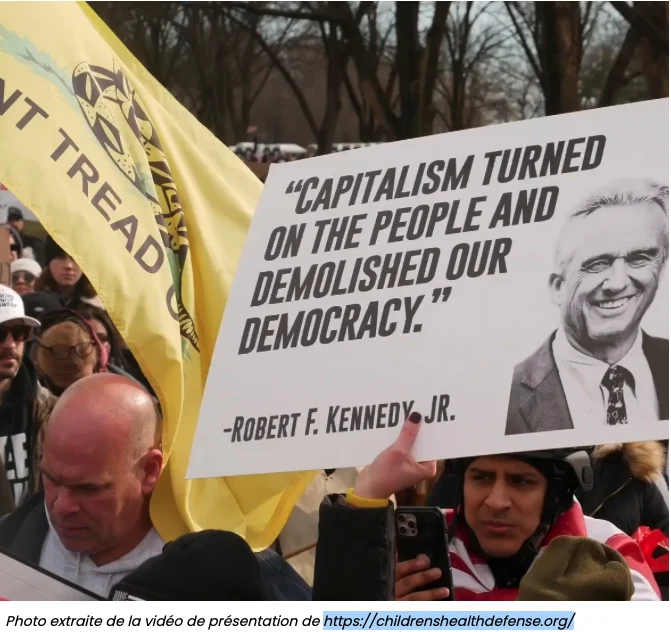En deux vagues récentes, les protestations contre les politiques antisociales de la France ont pris un nouvel élan. Ces dernières années, de nombreuses manifestations ont été organisées contre les réformes du marché du travail et des retraites, avec un pic le 7 mars 2023, lorsque 3,5 millions de personnes, selon les estimations des syndicats, ont protesté contre la réforme des retraites. Cette année, deux journées d’action nationales ont déjà eu lieu : la première le 10 septembre sous le slogan « Bloquons tout ! » et la seconde le 18 septembre sous le slogan « Les sacrifices pour le monde du travail, ça suffit ! ». Outre les manifestations et les blocages, de nombreuses grèves ont été organisées, en particulier lors de la deuxième journée d’action. Ces mobilisations ont été précédées par la défaite spectaculaire du gouvernement français lors d’un vote de confiance à l’Assemblée nationale le 8 septembre, laissant le Premier ministre nouvellement nommé par le président Macron à la tête d’un gouvernement intérimaire.
Source : Etos Media, 26 Sep 2025, Armin Duttine
Grèves de base et structures syndicales
Par rapport à l’Allemagne, les grèves en France trouvent souvent leur origine à la base et sont décidées localement dans ce que l’on appelle les assemblées générales, auxquelles même les employés non syndiqués peuvent participer. Avec seulement 10 % des travailleurs syndiqués, la France a l’un des taux de syndicalisation les plus bas d’Europe, bien que le taux de syndicalisation dans le secteur public soit plus élevé. Contrairement à l’Allemagne, les travailleurs français disposent d’un droit de grève individuel, y compris pour des objectifs politiques. En outre, la France ne dispose pas d’un système syndical unifié comparable au DGB allemand, mais plutôt d’une variété de confédérations syndicales souvent distinctes sur le plan politique. Les syndicats de gauche – la CGT (deuxième fédération syndicale et la plus importante dans le secteur public), Solidaires et la FSU (principalement dans l’éducation), parfois avec la CGT-FO – organisent fréquemment des actions conjointes, notamment lors de précédentes batailles contre la réforme des retraites et du droit du travail. Des coalitions plus larges sont parfois constituées, comme lors de la deuxième journée d’action de cette année, où même des syndicats modérés comme la CFDT (officiellement la plus grande confédération), l’UNSA, la CFE-CGC (pour les cadres) et la CFTC, d’orientation chrétienne, se sont joints aux mobilisations.
Première journée d’action : 10 septembre
La première journée s’est inspirée de l’appel aux blocages lancé par des cercles anarchistes en 2016 lors de la réforme du travail de Hollande, qui s’est largement répandu via les médias sociaux. Le mouvement a rapidement reçu le soutien de La France Insoumise (LFI) et des sections syndicales locales de la CGT, de Solidaires et de la CGT-FO. Des secteurs syndicaux entiers ont également lancé des appels à l’action, notamment les fédérations CGT de la santé et des services sociaux, des collectivités locales et des industries chimiques. Alors que les deux journées d’action de septembre ont d’abord été débattues comme des initiatives concurrentes, la CGT et nombre de ses fédérations les ont soutenues toutes deux.
Le 10 septembre, jusqu’à 250 000 personnes sont descendues dans la rue. Les manifestations ont eu lieu dans tout le pays, y compris dans les petites villes, mais surtout dans l’ouest de la France, politiquement orienté à gauche. Les grèves ont touché des services tels que les transports publics parisiens, la maintenance des trains de la SNCF et l’éducation, la CGT et Solidaires jouant un rôle de premier plan. Le mercredi étant une journée de travail allégée en France en raison des horaires scolaires, de nombreux salariés ont pu participer à titre individuel. Outre les syndicalistes, les participants comprenaient des sympathisants de LFI, des groupes autonomes (y compris des manifestants devant le siège de la CGT), d’anciens Gilets jaunes, des étudiants et des élèves. Une grande partie de la mobilisation a été menée par des participants plus jeunes, notamment par le biais de blocages d’écoles et d’universités. Toutefois, les actions de blocage ont été rapidement dispersées par les 80 000 policiers et gendarmes déployés.
Deuxième journée d’action : 18 septembre
La deuxième journée de grève et d’action a connu une participation beaucoup plus importante, les sources syndicales évoquant environ 1 million de participants, soit le double de la première journée. Les appels à la mobilisation ont été lancés conjointement fin août par les organisations faîtières CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA, FSU et Solidaires, couvrant ainsi la quasi-totalité du spectre syndical. Les étudiants et les lycéens ont également participé au mouvement en bloquant de nombreux établissements. Les grèves du personnel enseignant ont été nombreuses ; selon les syndicats de la FSU, un tiers des enseignants du primaire et environ 45% dans les collèges et lycées ont fait grève. À Toulon, les manifestants ont associé leurs protestations à des actions de solidarité en faveur de deux élèves arrêtés lors d’un blocage d’école. Les manifestations ont également fait le lien entre la lutte contre l’austérité et les appels à la paix, en particulier à Gaza, puisque des drapeaux palestiniens ont été hissés lors des défilés. La marche de Grenoble, par exemple, s’est déroulée sous le slogan : « Contre la casse sociale, pour la paix, l’égalité et la justice ! ». D’importantes manifestations ont lieu à Paris, ainsi que dans le sud et l’ouest du pays.
Revendications syndicales et retombées politiques
La première journée d’action a été consacrée à l’opposition aux mesures d’austérité de 44 milliards d’euros prévues par le gouvernement et présentées par le cabinet du Premier ministre Bayrou. Les groupes participants ont revendiqué des services publics, une augmentation des salaires et des pensions, une justice fiscale et une transformation écologique. L’appel syndical du mois d’août précédant les actions du 18 septembre a rejeté de nombreux projets du gouvernement : suppression de deux jours fériés, réduction des services publics, durcissement du droit du travail, nouvelle réforme du chômage, gel des prestations sociales et des salaires de la fonction publique, découplage des retraites de l’inflation, doublement du ticket modérateur, et même remise en cause de la cinquième semaine de congés payés en France. Ils ont également dénoncé les allégements fiscaux accordés aux riches et les 211 milliards d’euros de subventions accordées aux grandes entreprises. Les syndicats réclament un financement suffisant des services publics, des mesures contre la précarité, des investissements dans une transition écologique équitable et la réindustrialisation, une protection contre les licenciements, la taxation des grandes fortunes et des plus hauts revenus, et l’annulation de la réforme des retraites de Macron portant l’âge de la retraite à 64 ans. Une pétition syndicale connexe avait déjà atteint 350 000 signatures à la fin du mois d’août.
Les syndicats ont donné au nouveau Premier ministre Lecornu jusqu’au 24 septembre pour réagir, avertissant que si l’on n’en tenait pas compte, d’autres grèves et manifestations suivraient rapidement. Il est fort probable qu’elles se poursuivent. Des discussions sont déjà en cours sur l’intensification de la lutte par des grèves reconductibles au lieu d’actions d’une seule journée. Le mécontentement généralisé à l’égard du gouvernement de M. Macron est évident : les deux tiers de la population sont opposés à ses politiques et près des deux tiers réclament sa démission, bien que son mandat s’achève au printemps 2027. LFI a axé sa campagne sur la démission de Macron et la tenue de nouvelles élections, des revendications largement relayées dans les rues. L’alliance de gauche « Nouveau Front Populaire », qui réunit LFI, le Parti socialiste, le Parti communiste et les Verts, est divisée sur cette question, les socialistes et les communistes s’étant montrés ouverts à l’idée de participer à un gouvernement. En revanche, les syndicats donnent la priorité aux réalisations politiques concrètes plutôt qu’aux appels à la démission ou aux élections.
Le Rassemblement national (RN), parti d’extrême droite, exige également la démission de M. Macron et des élections anticipées, mais son rôle dans les manifestations de rue reste incertain. Alors que l’on craignait initialement que l’extrême droite se joigne en grand nombre aux manifestations, cela ne s’est pas concrétisé, bien que le RN continue de mener les sondages dans les enquêtes politiques.
Dimension européenne
Les manifestations françaises ont déjà attiré l’attention en Allemagne. Le 17 septembre, le président de ver.di, Frank Werneke, a publié une déclaration de solidarité : « Le combat des syndicats français est aussi le nôtre : pour la justice sociale, pour la protection et l’extension de l’État-providence, pour un travail décent et pour la dignité de la vieillesse.
Alors que de nombreux pays européens, dont l’Allemagne, se préparent à des coupes sociales similaires et à une érosion des droits du travail, notamment dans le cadre des budgets liés à la guerre, la question se pose de savoir si le mouvement français pourrait marquer le début d’une vague de protestation à l’échelle de l’Europe. Parmi les événements importants à venir, citons la conférence internationale sur la paix qui se tiendra à Paris les 4 et 5 octobre 2025, avec la participation des syndicats, et la journée d’action de la Confédération européenne des syndicats (CES) prévue pour le 16 février 2026.