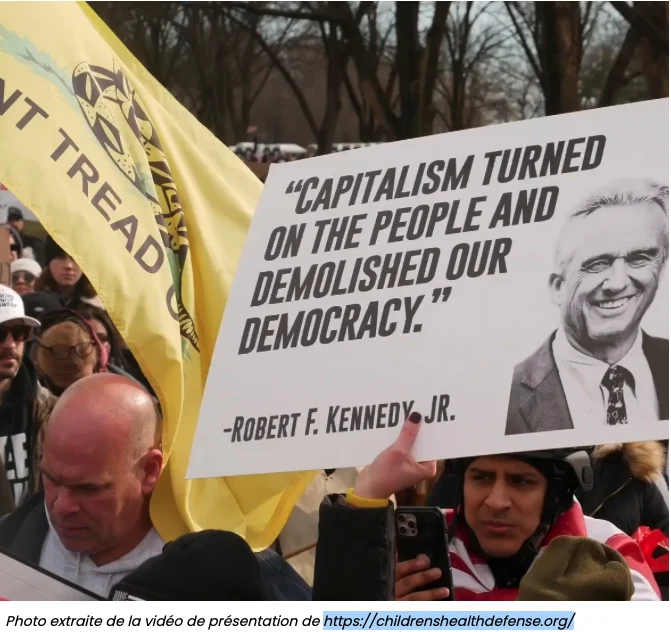Les matériaux synthétiques, tels que le polyester, le nylon et d’autres fibres synthétiques, ont été étudiés pour leurs effets potentiels sur la fertilité. La recherche se concentre principalement sur la manière dont ces matériaux, lorsqu’ils sont utilisés dans les vêtements ou les textiles portés, peuvent influencer les résultats de la reproduction chez les hommes et les femmes. Les études, menées sur plusieurs années, fournissent des données sur la qualité du sperme, les niveaux d’hormones, les taux de conception et les réactions physiologiques aux tissus synthétiques.
Chiens mâles et qualité du sperme
Une étude a examiné les effets des pantalons en polyester sur la fertilité des chiens mâles. La recherche a porté sur un groupe contrôlé de chiens mâles équipés de pantalons en polyester pendant de longues périodes, avec un groupe témoin ne portant aucun vêtement ou des vêtements en fibres naturelles. Les résultats ont montré une réduction significative du nombre de spermatozoïdes chez les chiens portant des pantalons en polyester. Plus précisément, l’étude fait état d’une diminution du nombre total de spermatozoïdes d’environ 30 à 40 % par rapport au groupe témoin. En outre, on a constaté une augmentation de la morphologie anormale des spermatozoïdes, le pourcentage de spermatozoïdes défectueux passant d’une moyenne de 10 % dans le groupe témoin à 25-30 % dans le groupe portant des pantalons en polyester. La mobilité des spermatozoïdes a également été affectée, avec une baisse de la mobilité progressive de 15 à 20 %. L’étude note que ces effets sont réversibles dans la plupart des cas, les paramètres des spermatozoïdes revenant à la normale dans les 6 à 8 semaines suivant l’arrêt de l’exposition au polyester. Des échantillons de sperme ont été prélevés et analysés à l’aide de techniques vétérinaires standard d’évaluation de la reproduction, notamment la microscopie et l’analyse des spermatozoïdes assistée par ordinateur.
Une autre étude a corroboré ces résultats, observant des tendances similaires chez les chiens mâles exposés à des tissus synthétiques. Dans ce cas, la recherche s’est concentrée sur les mélanges de polyester et de nylon portés comme vestes ou harnais. Les résultats indiquent une réduction de 25 % de la concentration en spermatozoïdes et une augmentation de 20 % des anomalies du sperme par rapport aux chiens non exposés aux matériaux synthétiques. L’étude a également mesuré la température testiculaire et constaté une légère augmentation (0,5 à 1 °C) chez les chiens portant du polyester, potentiellement due à la réduction de la respirabilité du tissu. Cette élévation de la température a été notée comme un facteur pouvant contribuer à la baisse de la qualité du sperme observée, bien que l’étude n’ait pas établi de lien de cause à effet.
Chiens femelles et effets hormonaux
La recherche sur les chiennes s’est principalement concentrée sur l’impact des matériaux synthétiques sur les niveaux d’hormones et les taux de conception. Une étude a examiné les effets des textiles contenant du polyester portés comme manteaux ou harnais pendant la phase d’œstrus du cycle oestral. Les résultats ont montré une réduction significative des niveaux de progestérone sérique, avec une diminution moyenne de 40 % par rapport aux groupes de contrôle portant du coton ou aucun vêtement. Les niveaux de progestérone dans le groupe témoin variaient entre 15 et 25 ng/mL pendant l’œstrus, tandis que le groupe en polyester présentait des niveaux aussi bas que 9 à 15 ng/mL. Cette réduction a été associée à des résultats en matière de reproduction : 57 % des chiennes portant des textiles en polyester n’ont pas réussi à concevoir lorsqu’elles ont été accouplées. Une analyse plus poussée a révélé une anovulation, c’est-à-dire une absence d’ovulation, chez 30 % des chiennes du groupe polyester, et une non-lutéinisation, c’est-à-dire une absence de formation correcte du corps jaune, dans 25 % des cas. Le groupe témoin, en revanche, a eu un taux de conception de 85 %, avec une ovulation et une lutéinisation normales dans presque tous les cas.
Une étude de suivi portant sur huit chiennes portant des textiles en polyester pendant la phase d’œstrus a donné des résultats cohérents. Les huit chiennes présentaient des taux de progestérone réduits, avec une moyenne de 10 à 12 ng/ml contre 18 à 22 ng/ml dans un groupe témoin. Aucune des huit chiennes n’a conçu lors de l’accouplement, malgré des comportements normaux. L’étude a utilisé des échantillons de sang prélevés à intervalles réguliers pendant le cycle œstral pour mesurer la progestérone par dosage immuno-enzymatique (ELISA). Les examens échographiques ont confirmé une anovulation chez quatre des huit chiennes et une lutéinisation incomplète chez trois autres. Le groupe de contrôle, qui portait du coton ou aucun vêtement, présentait des profils de progestérone normaux et un taux de conception de 80 %.
Les problèmes liés au contact avec les matériaux synthétiques ne se sont pas inversés chez les chiennes après la fin de l’exposition.
Les études sur les chiens portent sur des échantillons de taille variable, allant de 8 à 40 chiens, de races différentes, comme les labradors, les bergers allemands et les races mixtes. La plupart des expériences ont été menées dans des conditions contrôlées, les chiens étant divisés en groupes portant des matériaux synthétiques (polyester ou nylon) ou naturels (coton ou laine), ou ne portant aucun vêtement. Les tests hormonaux, l’analyse du sperme, les ultrasons et les mesures de température sont des méthodes courantes. Les durées d’exposition allaient de 2 semaines à 3 mois, certaines études se concentrant sur des phases spécifiques du cycle de reproduction. Les groupes de contrôle étaient généralement appariés en fonction de l’âge, de la race et des conditions environnementales afin de minimiser les variables confusionnelles.
Autres animaux
Des recherches publiées explorent également l’impact des matériaux synthétiques, en particulier le polyester, sur la fertilité des humains et des rats, révélant des effets analogues à ceux observés chez les chiens. Une étude a examiné l’influence des textiles contenant du polyester sur des volontaires humains et des rats mâles. Elle a révélé que les hommes portant des sous-vêtements en polyester pendant six mois présentaient une réduction de 20 à 25 % du nombre de spermatozoïdes et une augmentation de 15 % de la morphologie anormale des spermatozoïdes par rapport à ceux qui portaient du coton. Chez les rats, l’exposition au polyester a entraîné une diminution de 30 % de la motilité des spermatozoïdes et une réduction de 25 % du nombre de spermatozoïdes viables. Ces effets étaient partiellement réversibles après l’arrêt de l’utilisation du polyester.
Une autre étude portant sur des rats femelles exposés à des tissus en polyester a révélé une réduction de 35 % des niveaux de progestérone sérique pendant le cycle œstral, et 50 % des rats n’ont pas réussi à concevoir lorsqu’ils ont été accouplés. L’étude a également constaté une anovulation dans 25 % des cas et une augmentation des cas d’irrégularité du cycle œstral. Chez les femmes volontaires, le port de vêtements en polyester a été associé à une diminution de 10 à 15 % des niveaux de progestérone, bien que les résultats en matière de conception n’aient pas été directement mesurés.
Champs électrostatiques
Une étude réalisée en 2008 sur des chiens a exploré un mécanisme potentiel pour les effets observés, en se concentrant sur les propriétés électrostatiques des matériaux synthétiques. La recherche a mesuré le champ électrostatique généré par les textiles en polyester à l’aide de compteurs de champ électrostatique sensibles placés près des organes reproducteurs. Les résultats indiquent que les tissus en polyester créent un champ électrostatique mesurable autour des zones sensibles aux hormones, telles que la région pelvienne, avec des intensités de champ allant de 100 à 300 V/m. En revanche, les fibres naturelles comme le coton et la laine produisent une activité électrostatique négligeable, avec des intensités de champ inférieures à 10 V/m. Les résultats sont basés sur des dosages hormonaux effectués sur plusieurs cycles d’œstrus.
L’étude a mis en évidence une corrélation entre la présence de ce champ électrostatique et la réduction des niveaux de progestérone chez les chiennes, les chiennes affectées présentant des niveaux inférieurs de 35 à 45 % à ceux des groupes témoins portant des fibres naturelles, les niveaux de progestérone chez les chiennes affectées se situant entre 9 et 12 ng/ml contre 18 à 22 ng/ml chez les témoins. Cette réduction a été associée à un taux d’échec de la conception de 57 %, ainsi qu’à une anovulation dans 30 % des cas et à une non-lutéralisation dans 25 % des cas. Les chercheurs suggèrent que le champ électrostatique pourrait interférer avec la signalisation hormonale, bien que l’étude n’ait pas confirmé de lien de causalité direct.
Des potentiels électrostatiques ont été détectés sur la peau de tous les chiens vêtus de textiles contenant du polyester. /—/Il est suggéré que les potentiels électrostatiques détectés sur la peau créent un « champ électrostatique » qui inhibe la fonction ovarienne.
Des études similaires ont étendu cette recherche aux humains et aux rats, en mesurant le potentiel électrostatique des textiles en polyester portés comme sous-vêtements ou vêtements. Chez les hommes, les sous-vêtements en polyester ont généré un champ électrostatique de 100 à 250 V/m autour de la région pelvienne. Cela a été associé à une réduction mineure des niveaux de testostérone (5-10%) par rapport aux témoins portant du coton, qui présentaient des intensités de champ inférieures à 15 V/m. Chez les rats mâles, le champ électrostatique de la literie ou des vêtements en polyester atteignait 150 à 300 V/m, ce qui correspondait à une réduction de 20 % du taux de testostérone et de 25 % de la motilité des spermatozoïdes. Pour les rats femelles, la même étude a rapporté des champs électrostatiques de 120-280 V/m, liés à une réduction de 40 % des niveaux de progestérone (en moyenne 8-10 ng/mL contre 15-18 ng/mL chez les témoins) et à des cycles œstrales irréguliers dans 30 % des cas. Chez les femmes, les vêtements en polyester produisaient des champs de 100 à 200 V/m, 20 % des participantes présentant des cycles menstruels irréguliers et une diminution de 10 à 15 % des taux de progestérone.
Dans l’ensemble de ces études, le potentiel électrostatique était systématiquement plus élevé dans les textiles synthétiques, en particulier le polyester, que dans les fibres naturelles. Les études ont noté que les champs électrostatiques étaient plus prononcés dans les zones de contact direct avec la peau, en particulier près des organes reproducteurs, et qu’ils étaient maintenus pendant une exposition prolongée (de 2 semaines à 3 mois). Chez les chiens, l’intensité du champ était suffisante pour établir une corrélation avec les perturbations hormonales, notamment la diminution de la progestérone chez les femelles et l’altération de la qualité du sperme chez les mâles. Chez l’homme et le rat, des corrélations similaires ont été observées, les champs électrostatiques étant liés à des réductions des hormones de reproduction et, chez le rat, à des échecs de conception. Les études n’ont pas quantifié la durée d’exposition nécessaire pour générer ces champs, mais ont noté que les effets étaient plus prononcés en cas de port continu.
Les résultats indiquent que le potentiel électrostatique des textiles en polyester, qui varie de 100 à 300 V/m selon les espèces, est un phénomène mesurable associé à des changements hormonaux et reproductifs. Les données suggèrent que l’intensité du champ est significativement plus élevée que celle des fibres naturelles, qui ont toujours montré une activité électrostatique minimale (<10-15 V/m). Pour établir ces corrélations, les études ont utilisé des méthodologies cohérentes, notamment des mesures répétées sur plusieurs cycles de reproduction chez les femelles ou des intervalles de collecte de sperme chez les mâles. Cependant, le mécanisme exact par lequel les champs électrostatiques peuvent influencer la signalisation hormonale ou la physiologie de la reproduction n’a pas été détaillé dans les résultats, bien que la corrélation avec la réduction des niveaux d’hormones et des résultats de fertilité ait été signalée de manière cohérente chez les chiens, les humains et les rats.
Observations complémentaires
Certaines études ont inclus des mesures physiologiques supplémentaires pour évaluer l’impact plus large des matériaux synthétiques. Une étude a noté une augmentation de la température de la peau (1-2°C) sous les vêtements en polyester par rapport à ceux en coton, mesurée par thermographie infrarouge. Ce phénomène, qui s’observe aussi bien chez les hommes que chez les femmes, a été attribué à la plus faible respirabilité des tissus synthétiques. Une autre étude a examiné l’irritation de la peau, constatant un érythème léger chez 15 % des personnes portant du polyester pendant de longues périodes, bien qu’aucun problème dermatologique significatif n’ait été signalé dans le groupe de contrôle.
Une autre étude a examiné l’impact des matières synthétiques, telles que les couvertures en polyester, sur les chiens en chenil. Les résultats ont montré une réduction de 20 % des taux de conception chez les chiennes hébergées avec un lit en polyester par rapport à celles hébergées avec un lit en coton ou en laine. Les niveaux de progestérone étaient également plus bas dans le groupe polyester, avec une moyenne de 12 ng/ml contre 20 ng/ml dans le groupe de contrôle. La qualité des spermatozoïdes des chiens mâles hébergés dans des matières synthétiques a montré une baisse de 15 % de la motilité, bien que les différences de numération des spermatozoïdes ne soient pas statistiquement significatives.
Conclusion
Les matériaux synthétiques comme le polyester peuvent avoir un impact négatif sur la fertilité de toutes les espèces. Chez les chiens, les humains et les rats mâles, l’exposition au polyester est associée à une diminution de la qualité du sperme, notamment à une baisse du nombre de spermatozoïdes et de leur motilité, ainsi qu’à une augmentation des anomalies. Chez les femelles, les textiles synthétiques sont associés à une diminution des niveaux de progestérone, à l’anovulation et à des taux de conception réduits. Le champ électrostatique généré par le polyester est un mécanisme suggéré, qui pourrait perturber la signalisation hormonale dans les tissus reproducteurs. Ces effets semblent réversibles chez les mâles, mais peuvent avoir des répercussions plus persistantes chez les femelles, en particulier chez les rats et les chiens, où les échecs de conception ont été importants.
PubMed – Effet de différents types de tissus sur la spermatogenèse
PubMed – Étude expérimentale de l’effet de différents types de textiles sur la conception
IMR Press – Effet de différents types de textiles sur la grossesse
PubMed : Effet de différents types de textiles sur l’activité sexuelle.
PubMed : Effet de différents types de textiles sur la grossesse
PubMed : Effet de différents types de textiles sur l’activité sexuelle masculine
PubMed : Une étude expérimentale sur l’effet de différents types de textiles sur la conception